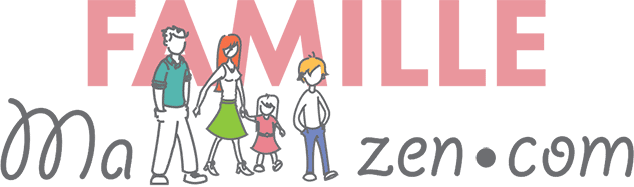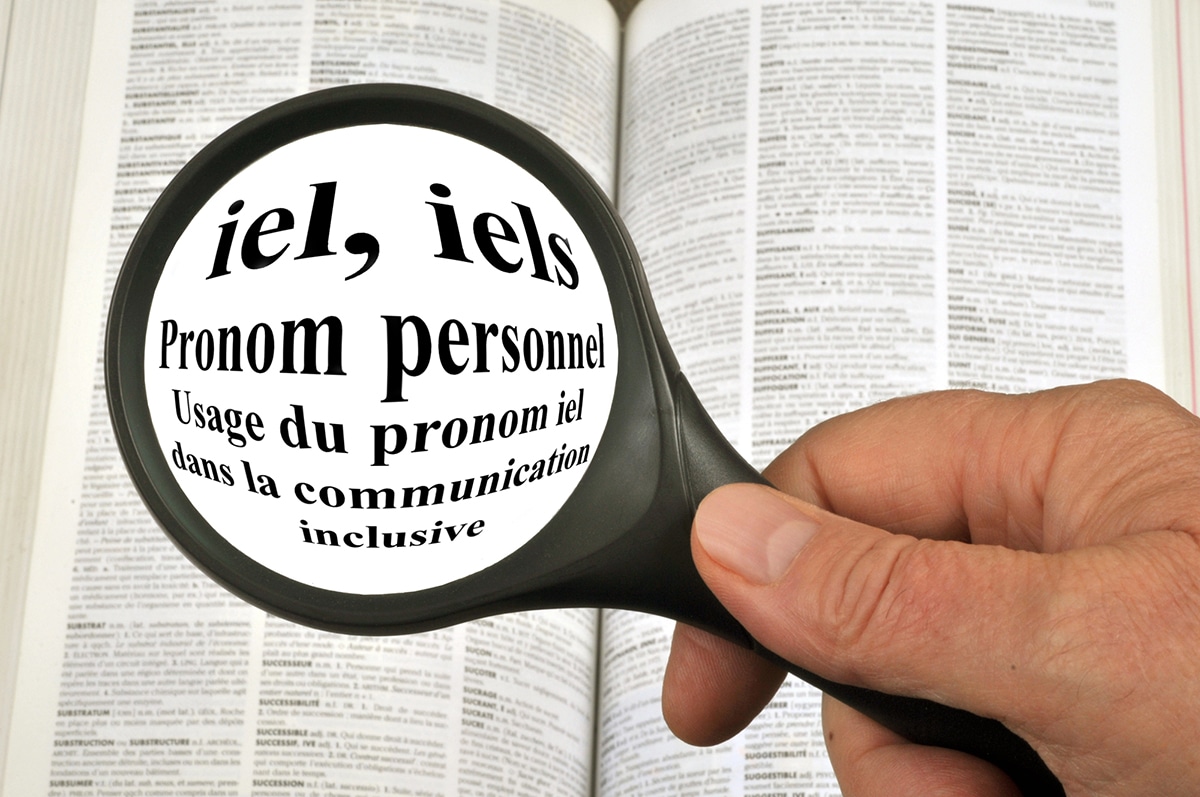
Le pronom “iel” dans l’édition papier du dictionnaire Le Robert, la féminisation des métiers et des titres à l’école, le bannissement des expressions sexistes telles qu’”en bon père de famille”, ou “le panier de la ménagère”… Notre langue évolue pour refléter les progrès de notre société qui aspire à plus d’égalité, et c’est bien normal ! L’écriture inclusive se présente comme un ensemble de règles visant à accompagner cette transformation. Pourtant, elle suscite encore de vives oppositions, par peur, conservatisme et conformisme. Qu’en pensent les 12-18 ans ?
Oui à l’inclusion du féminin quand c’est possible, non à la complexité excessive
Hugo, 14 ans, est favorable à la féminisation des noms de métiers (« une autrice », « une professeure ») et à la distinction claire entre les genres lorsqu’on désigne des groupes de personnes (« celles et ceux », « les directeurs et directrices », plutôt que le seul masculin). Il approuve également l’emploi de termes neutres comme « droits humains » au lieu de « droits de l’homme ». Cependant, le collégien de troisième est contre le recours aux formules de graphies inclusives telles que : les employé.e.s, celleux, iels, car pour lui, il ne faut pas chercher à dénaturer la langue. Par conséquent, le masculin pluriel doit l’emporter pour désigner des employés d’une entreprise par exemple, même si l’équipe est composée d’hommes et de femmes.
Pour Hugo, une représentation plus juste de la société à travers la langue est essentielle, et la prise en compte du pluriel féminin dès que possible lui semble naturelle. Néanmoins, il exprime une limite claire : « OK pour allonger un peu la phrase afin d’inclure le féminin. Par contre, dès que c’est gênant visuellement, ou atypique, ça devient trop compliqué ». Hugo est donc motivé pour changer ses habitudes de lecture et d’écriture, mais il ne faut pas que la langue devienne trop « révolutionnaire ».
« Il y a des choses plus importantes dans la vie »
Son cousin, Kylian, âgé de 17 ans, partage un avis similaire concernant la féminisation des métiers. Cependant, il se montre moins favorable à la distinction systématique entre hommes et femmes dans la désignation des groupes : « On met tout au masculin pluriel, exemple : les directeurs et non pas les directeurs et directrices, et on n’utilise pas non plus de formulations inclusives telles que iels, celleux, directeur·ice·s etc…». Telle est sa position sur la question.
À l’instar d’un certain nombre de jeunes, c’est un mélange de « flemme » et de désintérêt pour les questions soulevées par l’écriture inclusive qui pousse Kylian à ne pas accorder une grande attention à ces enjeux. Pour lui, « il y a des choses plus importantes dans la vie ». Ce désengagement apparent peut s’expliquer par un manque d’information ou par une perception de ces débats trop éloignés des préoccupations quotidiennes.
Un effort grammatical perçu comme un pas vers une société plus équitable
Lucas, 18 ans, observe autour de lui que peu de jeunes utilisent l’écriture inclusive, et que beaucoup n’en ont qu’une vague idée : « Je ne pense pas qu’il y ait de débat, ni de rejet, juste un gros manque d’information ou d’intérêt, pour l’instant ».
Pourtant, à titre personnel, Lucas se montre très favorable à l’écriture inclusive, y compris dans ses formes les plus élaborées : « Les formes abrégées sont efficaces, faciles à comprendre et à utiliser, elles ne « choquent » pas à la lecture. Je pourrais tout à fait m’habituer à les voir dans des articles, à la télévision, ou même dans des manuels scolaires ».
Pour cet élève de terminale, si l’écriture inclusive demande un certain effort grammatical, il y voit avant tout un mouvement porteur de sens vers une société plus juste : « Nous pourrions collectivement basculer vers cette forme innovante, à condition d’y être sensibilisés, éduqués, et formés, dès le plus jeune âge. Et cela passe sans doute par l’école, l’université, mais aussi la presse, qui devraient normaliser ce langage ».
La super idée de Lucas pour faciliter l’usage de l’écriture inclusive
Lucas propose même une idée novatrice pour faciliter l’adoption de l’écriture inclusive : « Je me suis dit que si un jour, par exemple, les claviers intègrent des suggestions automatiques de graphies inclusives, ou si les manuels du ministère de l’Éducation nationale s’y mettent, je pense que la société suivra petit à petit ». Cette suggestion met en lumière le rôle potentiel des outils technologiques et des institutions éducatives dans la démocratisation de ces nouvelles formes linguistiques.
L’éducation nationale : un terrain encore peu fertile pour l’écriture inclusive
Caroline Coupez est Déléguée générale de Solidarité Laïque, une organisation engagée pour une éducation publique de qualité en France et dans plus de 20 pays. Son ONG a pris position en faveur de l’écriture inclusive, l’environnement des éducateurs et des enseignants au sein duquel elle évolue étant généralement plus mobilisés sur les enjeux d’inclusion et d’égalité, y compris dans les projets menés auprès des jeunes. Elle est également mère de deux adolescents de 14 et 18 ans, eux aussi sensibilisés à cette question.
Comme le souligne Lucas, « on ne parle quasiment pas de l’écriture inclusive à l’école, car le système reste très traditionnel ». Caroline Coupez constate également que les élèves autour d’elle ne l’utilisent pas : jugé « trop long« , notamment pour les dissertations. De plus, « certains profs ne la tolèrent pas ». Ainsi, le recours à l’écriture inclusive demeure une initiative personnelle, tant pour les élèves que pour le personnel éducatif.
Les usages (ré)créatifs de l’écriture inclusive chez les jeunes
Si son usage reste marginal dans les travaux scolaires, l’écriture inclusive peut trouver un écho dans des contextes plus informels et créatifs. « Pour une affiche, un exposé, les élèves peuvent se poser la question d’y recourir… pour écrire dans le journal du lycée… Appeler Toutes et Tous à venir nombreux au prochain match. etc. », contextualise Caroline Coupez. Pour la Déléguée générale, ces générations sont plus en quête d’égalité et n’hésitent pas à « casser des vieux codes ». Cela passe aussi par des actions symboliques dans leur manière de s’exprimer.
Avec ou sans l’écriture inclusive, la langue reste un enjeu d’égalité
Caroline Coupez insiste : « La priorité n’est pas l’écriture inclusive dans l’École, pourtant, il faut lutter contre le langage et les éléments de langage sexistes… qui véhiculent des préjugés, des représentations faussées ». Ces représentations sont alimentées par des courants de masculinité toxique qui reviennent en force dans nos sociétés, y compris à travers la manipulation de certains jeunes qui y sont exposés sur les réseaux sociaux.
« Mais rendre acceptable cette écriture et le sens qu’elle porte, la banaliser à terme en l’utilisant librement, en permettant à toutes les générations de se l’approprier, c’est faire acte de non-discrimination, c’est considérer avec égalité que la langue française est vivante, progressive et qu’elle accepte tous les genres », conclut la professionnelle de l’éducation.
Petit rappel sur l’écriture inclusive
Pourquoi l’écriture inclusive ?
Comme son nom l’indique, l’écriture inclusive ambitionne de rendre la langue française plus représentative de la diversité de notre société : une communauté humaine composée de femmes, d’hommes, de personnes LGBTQIA+, où « le masculin ne l’emporte pas toujours sur le féminin ».
La langue possède un pouvoir créateur, et le français actuel reflète encore les inégalités de notre société. Historiquement formatée par des règles édictées par l’Académie française, institution garante de la langue française créée au 17ème siècle, c’est à cette époque que le français a progressivement intégré un biais sexiste, invisibilisant les femmes et renforçant les stéréotypes de genre.
Ce processus s’est notamment appuyé sur le principe selon lequel : « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin, à cause de la supériorité du mâle sur la femelle » (Beauzée, Grammaire générale, 1767). L’écriture inclusive se présente comme une tentative de déconstruire cette vision patriarcale de la société qui perdure dans nos manières de parler et d’écrire.
Une écriture inclusive encore contestée
Depuis une trentaine d’années, une évolution progressive s’opère dans les institutions avec la féminisation des noms de fonctions, de métiers, de titres et de grades. Il aura fallu attendre un décret de loi datant de 1984 (validé par l’Académie française en 2019 seulement) pour que la possibilité de dire « la directrice », « la ministre », « l’autrice »…soit officiellement reconnue.
Cependant, cette évolution se heurte au conservatisme d’une société encore marquée par une certaine domination masculine – favorable à une féminisation limitée de la langue, mais opposée à la révolution linguistique que propose l’écriture inclusive. Pour certains linguistes, politiciens (dont des sénateurs prônant son interdiction) et membres de l’éducation nationale, elle est jugée trop complexe et source de polémiques inutiles, augmentant les difficultés d’apprentissage et créant un dilemme moral constant. Ils préfèrent se rallier à la théorie d’un masculin dit « générique » et neutre, une conception que l’écriture inclusive cherche à déconstruire.
Qu’est-ce que l’écriture inclusive ? Quelques règles
Voici quelques-unes des règles proposées par l’écriture inclusive pour tendre vers une langue française véritablement égalitaire :
- La féminisation des noms de fonctions (« autrice » ou « auteure » et non uniquement « auteur »).
- Le dédoublement des noms (« lecteurs et lectrices »).
- L’accord de proximité (« les lecteurs et les lectrices sont exigeantes », et non « exigeants »).
- Le point médian ou les graphies abrégées (« nous sommes impliqué·e·s »).
- L’utilisation de pronoms non genrés tels que « iel ».
Les partisans de l’écriture inclusive reconnaissent que l’application de ces règles demande un temps d’adaptation, mais soulignent que certaines peuvent être intégrées facilement (comme le dédoublement) ou le sont déjà (comme la féminisation des titres).
La conclusion de Lucas : les générations futures ont la capacité de s’adapter. « Honnêtement, je ne pense pas que ce soit une question de complexité, mais plutôt d’habitude. Avec un peu de sensibilisation, dès le plus jeune âge, à l’école, mais aussi chez les adultes, cela pourrait devenir aussi naturel que la règle des signes en mathématiques par exemple. Personnellement, je serais prêt à l’utiliser si j’étais formé ou accompagné là-dessus, peut-être même à travers des ateliers ou des cours spécifiques ».
Vous avez aimé cet article ou bien vous voulez réagir ?